L’affaire de Had Soualem et ses implications juridiques : éclairage sur les mécanismes de lutte contre le financement du terrorisme au Maroc et les obligations de vigilance des acteurs économiques.
L’opération antiterroriste menée avec succès à Had Soualem le 26 janvier 2025, neutralisant une cellule liée à Daech préparant des attentats imminents, met en exergue l’efficacité du dispositif sécuritaire marocain. Toutefois, au-delà de la réussite opérationnelle, cette affaire soulève une question fondamentale, trop souvent reléguée au second plan : comment cette cellule a-t-elle pu financer ses activités criminelles ?
L’acquisition de produits chimiques, la location d’un local et la confection d’engins explosifs impliquent nécessairement des ressources financières. Or, identifier l’origine de ces fonds est crucial, non seulement pour démanteler les réseaux existants, mais surtout pour anticiper et prévenir de futures menaces.
L’ANRF : un acteur clé dans l’ombre
Si le BCIJ, agissant sur la base d’informations fournies par la DGST, a pu intervenir à temps pour neutraliser la menace imminente, il est fort probable que l’ANRF ait joué un rôle clé en amont de l’opération. En effet, l’ANRF, en tant que cellule de renseignement financier, est chargée de collecter et d’analyser les informations relatives aux opérations financières suspectes, notamment celles pouvant être liées au financement du terrorisme.
Imaginons le scénario suivant : des institutions financières « IF », en appliquant leurs obligations de vigilance conformément à la loi n° 43-05 telle que modifiée et complétée par la loi n° 12-18 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et aux textes de l’ANRF, ont détecté des transactions suspectes liées aux individus impliqués dans l’affaire de Had Soualem. Ces transactions auraient pu concerner l’achat de produits chimiques en grande quantité, des mouvements de fonds inhabituels ou des virements vers des bénéficiaires situés dans des zones à risque.
Alertée par les IF, via des déclarations de soupçons, l’ANRF aurait analysé les informations et transmis des renseignements précieux au parquet. Ces renseignements auraient pu permettre d’identifier les membres de la cellule terroriste, de localiser leurs lieux de résidence et de confirmer leurs intentions criminelles.
Plongée dans les méandres du financement du terrorisme
Si l’enquête est encore en cours, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, chacune présentant des défis spécifiques en termes de détection et de répression :
- Le financement externe: L’implication d’organisations terroristes internationales, notamment via des transferts de fonds transfrontaliers, est une piste sérieuse. Le Maroc, de par sa stabilité et son engagement dans la lutte antiterroriste, constitue une cible pour ces organisations qui cherchent à déstabiliser la région. Ce type de financement, souvent complexe et sophistiqué, requiert une coopération internationale renforcée et un partage efficace du renseignement.
- L’autofinancement: La cellule aurait pu recourir à des activités illégales pour générer ses propres ressources. Trafic de drogue, vol, extorsion de fonds, les possibilités sont nombreuses. La lutte contre ces activités criminelles connexes est donc indissociable de la lutte contre le terrorisme. Elle nécessite une coordination étroite entre les différents services de sécurité et de renseignement.
- Le microfinancement: Internet et les réseaux sociaux ont facilité le recours au microfinancement, où de petites sommes d’argent, collectées auprès de sympathisants, peuvent financer des activités terroristes. Ce mode de financement, difficile à détecter, pose de nouveaux défis aux autorités. Il exige une surveillance accrue du cyberespace et une coopération avec les plateformes numériques.
- Le financement local: Des entreprises ou des individus, sciemment ou non, auraient pu fournir des fonds ou du matériel à la cellule. L’affaire de Had Soualem met en lumière la responsabilité des acteurs économiques dans la prévention du financement du terrorisme. L’obligation de vigilance, inscrite dans la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme, impose aux professionnels de connaître leurs clients, de détecter les opérations suspectes et de les signaler à l’ANRF.
Le cadre juridique marocain : un arsenal en constante évolution
Le Maroc a développé un cadre juridique robuste pour contrer le financement du terrorisme, notamment avec la loi n° 03-03 qui criminalise le financement des actes terroristes et prévoit des sanctions sévères. Cette loi s’inscrit dans le cadre des engagements internationaux du Maroc, notamment les conventions des Nations Unies et les recommandations du GAFI (Groupe d’action financière).
L’ANRF joue un rôle central dans la détection et la prévention du financement du terrorisme. Elle collecte et analyse les déclarations de soupçons, diffuse des recommandations aux professionnels et coopère avec ses homologues étrangers.
Vers une vigilance collective renforcée
L’affaire de Had Soualem rappelle que la lutte contre le financement du terrorisme est un défi collectif qui nécessite la mobilisation de tous. Au-delà des efforts des autorités, la vigilance des citoyens, des entreprises et des institutions financières est essentielle. La sensibilisation, la formation et le partage d’informations sont des leviers clés pour renforcer cette vigilance collective.
Le démantèlement de la cellule de Had Soualem est une victoire importante dans la lutte contre le terrorisme. Mais cette affaire met également en lumière la nécessité de redoubler d’efforts pour tarir les sources de financement du terrorisme. Seule une approche globale et multidimensionnelle, combinant action sécuritaire, coopération internationale et engagement de la société civile, permettra de relever ce défi majeur.
Source
Consulter l’article ici.
Pas encore utilisateur Lexis®MA ? Réservez immédiatement votre démonstration sur Demande de démo LexisMA
Pour découvrir davantage d’actualités et d’autres contenus juridiques disponibles, rendez-vous sur LexisMA.com
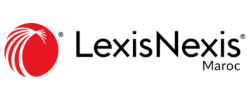


Ajouter un commentaire